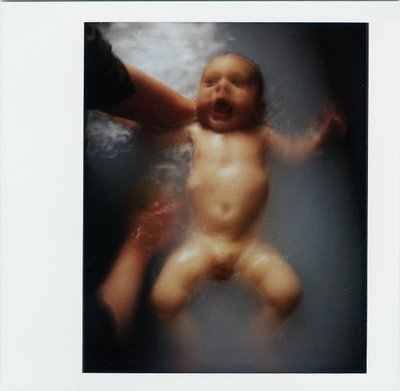mercredi, mai 31, 2006
Vu le film Truman Capote, sur les recommandations de plusieurs amis. Remarquable, comme on me l'avait dit. Où quand un écrivain las des honneurs, s'en retourne aux marges pour y retrouver le feu (encore les marges, cela m'obsède). Ce feu c'est un fait divers survenu dans l'Amérique profonde, une famille sauvagement assassinée, deux meurtriers un peu simples d'esprit. Il est fascinant de voir comment Capote enquête : il s'immerge dans l'histoire de ces hommes, prend des notes, ébauche un récit, cherche une position. Un temps convaincu de leur innocence, il est bientôt forcé de ce confronter à la réalité : les deux hommes sont bel et bien coupables. Mais il est trop tard pour reculer : le récit ne sera pas celui que l'on escomptait. Problème de la distance au personnage – position intenable pour Capote qui s'est lié avec les deux hommes (leur trouvant un bon avocat, leur rendant visite en prison, etc.). Et position intenable pour l'écrivain, dans la mesure où l'objet de tout récit est la question du rachat. Que faire alors sinon décrire les faits qui ont conduit à l'inqualifiable, essayant d'être tour à a tour chacun – mais l'objectivité est un leurre. Après avoir écrit l'histoire de ces héros, l'écrivain est exsangue. Sa mission est à la fois accomplie et échouée. Quand le rachat du héros est impossible, l'écrivain déchoit. La marginalité du meurtrier aura eu la peau de Capote. Au moment de tomber le masque, les séquelles sont là : il n'écrira plus rien après ce livre intitulé De sang froid. Cette quête très violente de l'inqualifiable est une trop haute solitude.
par ALAIN LACROIX, le mardi 30 mai 2006
Je lis en ce moment le Journal de Louis Calaferte, cela s'appelle Traversée, Carnets /Volume XII /1990. Je me souviens de ma découverte éblouie, il y plus de dix ans, de Septentrion, qui venait de paraître en poche. Le sentiment d'être en présence d'une voix, libre et subversive. Mais surtout profondément moderne (Septentrion date de 1963, et pourtant c'est une bombe). Puis d'autres livres suivirent, plus délicats pour certains, comme Rosa mystica, portrait d'une adolescente touchée par la grâce.
Le plus frappant dans ces Carnets c'est cette souffrance devant le peu de reconnaissance dont il jouit – (à raison). Reconnaissance qui ne viendra qu'après sa mort, malheureusement. Voire: je m'étonne du peu d'évènements organisés autour de son œuvre, alors qu'elle est essentielle pour beaucoup de gens de ma génération.
Dommage – nous qui le découvrions aurions pu être ses amis, de quelque "réconfort" pour le vieil homme muré dans son exil célinien.
Un écrivain en marge, comme je les aime. Et qui reste, quelque part, en marge (de l'inconvénient de ne pas être un homme de salon). Il faut demeurer vigilant : c'est "nous", lecteurs attentifs, qui portons sa survie, puisque les Institutions rechignent.
La marginalité est fondamentale, pour qui écrit. Je ne le conçois pas autrement.
Le plus frappant dans ces Carnets c'est cette souffrance devant le peu de reconnaissance dont il jouit – (à raison). Reconnaissance qui ne viendra qu'après sa mort, malheureusement. Voire: je m'étonne du peu d'évènements organisés autour de son œuvre, alors qu'elle est essentielle pour beaucoup de gens de ma génération.
Dommage – nous qui le découvrions aurions pu être ses amis, de quelque "réconfort" pour le vieil homme muré dans son exil célinien.
Un écrivain en marge, comme je les aime. Et qui reste, quelque part, en marge (de l'inconvénient de ne pas être un homme de salon). Il faut demeurer vigilant : c'est "nous", lecteurs attentifs, qui portons sa survie, puisque les Institutions rechignent.
La marginalité est fondamentale, pour qui écrit. Je ne le conçois pas autrement.
lundi, mai 29, 2006
par ALAIN LACROIX, le lundi 29 mai 2006
Comme je suis vôtre hôte jusqu'à Dimanche, les présentations sont nécessaires : j'ai 34 ans, je vis à Lyon et publie des textes dans des revues littéraires depuis quatre ans. Je suis entrain de terminer un roman Constellation, sur lequel j'ai beaucoup sué. Pour le reste ne me demandez pas d'où je tire ma subsistance : c'est secret.
En ce moment mes journées sont faîtes d'écriture et de lectures, ce blog en sera sûrement le reflet. Enfin nous verrons.
Aujourd'hui ai envoyé ce mail à une amie qui participe à un concours de nouvelles. Elle voulait mon avis sur son texte.
*
Hello M.
Bon, ravi que tu aies entendu certaines de mes suggestions
pour les autres libre à toi
je peux me tromper
c'est toujours difficile d'avoir de la lucidité sur son propre travail, du recul
simplement deux choses (pour partager quelques réflexions avec toi, et pas du tout pour te faire la leçon):
On ne fait jamais assez confiance aux mots
et au lecteur
Quand on a dit une fois une chose, c'est imprimé dans sa tête
et c'est inutile de le répéter (c'est en ce sens que je parlais de quelques "redondances")
or on a toujours tendance à être trop "explicatif" au moment de l'écriture (cela fait plus partie du son propre processus d'éclaircissement à soi, que de ce qui est requis).
En outre tout ce que tu veux faire passer est aussi contenu dans le "Contexte": en gros, passé la page 1, on a fait sa photographie mentale du lieu et de la situation que tu as posé et il y a moins besoin d'éléments descriptifs, que tu as tendance à le croire.
Une comparaison cinématographique : si le début d'un film, pour des raisons d'"installation", doit être en plan fixe, respectant le temps de la compréhension nécessaire,
la suite peut être en caméra à l'épaule, rapide. Ce qui est acquis est acquis.
On a alors moins besoin de détails techniques (même s'il te tiennent à cœur) que d'enjeu dramatique: c'est davantage les rapports entre les personnages, toi, et la progression narrative de l'ensemble, qui comptent. Or, à ce moment-là, trop de détail freine la lecture, au moment ou l'on attend que les choses avancent.
La logique me semble-t-il, c'est : plus un récit approche de la fin, plus il doit être elliptique, plus il peut aller vite, et plus le lecteur est intelligent (dans le sens ou la mécanique subjective assimile très vite : c'est la magie du processus de lecture). A ce stade là les mots sont de pures vitesses, on peut se permettre d'être très allusif. La mémoire du lecteur est comme une base de données : un seul mot tire avec lui tout un contexte. L'essentiel est fait. C'est alors qu'on peut s'amuser avec ses créatures.
Deuxième chose, sur le recul dont je parlais:
L'écrivaine Joyce Carol Oates a expliqué dans une interview qu'elle écrivait d'abord ses textes ( y travaillant avec acharnement comme toi et moi, je suppose)
puisqu'elle les laissait reposer ensuite un an sans les relire
"le temps de s'en détacher affectivement" (je cite ses mots).
Elle pouvait ensuite, j'imagine, en faire une lecture à la fois objective et technique.
Un luxe d'écrivain accompli que nous n'avons malheureusement pas le temps de nous permettre.
Voilà, quant à tes corrections, ça me parait bien pour autant que je puisse en juger. Le nouveau titre est mieux, aussi.
Bonne chance pour le concours, donc.
On se tient au courant, à bientôt.
*
Voilà, en guise de leçon - .
Leçon qui a aussi le mérite d'éclaircir les idées de son auteur.
Demain, d'autres éléments sur ce mode.
Une façon de faire un (auto)portrait dans le texte.
En ce moment mes journées sont faîtes d'écriture et de lectures, ce blog en sera sûrement le reflet. Enfin nous verrons.
Aujourd'hui ai envoyé ce mail à une amie qui participe à un concours de nouvelles. Elle voulait mon avis sur son texte.
*
Hello M.
Bon, ravi que tu aies entendu certaines de mes suggestions
pour les autres libre à toi
je peux me tromper
c'est toujours difficile d'avoir de la lucidité sur son propre travail, du recul
simplement deux choses (pour partager quelques réflexions avec toi, et pas du tout pour te faire la leçon):
On ne fait jamais assez confiance aux mots
et au lecteur
Quand on a dit une fois une chose, c'est imprimé dans sa tête
et c'est inutile de le répéter (c'est en ce sens que je parlais de quelques "redondances")
or on a toujours tendance à être trop "explicatif" au moment de l'écriture (cela fait plus partie du son propre processus d'éclaircissement à soi, que de ce qui est requis).
En outre tout ce que tu veux faire passer est aussi contenu dans le "Contexte": en gros, passé la page 1, on a fait sa photographie mentale du lieu et de la situation que tu as posé et il y a moins besoin d'éléments descriptifs, que tu as tendance à le croire.
Une comparaison cinématographique : si le début d'un film, pour des raisons d'"installation", doit être en plan fixe, respectant le temps de la compréhension nécessaire,
la suite peut être en caméra à l'épaule, rapide. Ce qui est acquis est acquis.
On a alors moins besoin de détails techniques (même s'il te tiennent à cœur) que d'enjeu dramatique: c'est davantage les rapports entre les personnages, toi, et la progression narrative de l'ensemble, qui comptent. Or, à ce moment-là, trop de détail freine la lecture, au moment ou l'on attend que les choses avancent.
La logique me semble-t-il, c'est : plus un récit approche de la fin, plus il doit être elliptique, plus il peut aller vite, et plus le lecteur est intelligent (dans le sens ou la mécanique subjective assimile très vite : c'est la magie du processus de lecture). A ce stade là les mots sont de pures vitesses, on peut se permettre d'être très allusif. La mémoire du lecteur est comme une base de données : un seul mot tire avec lui tout un contexte. L'essentiel est fait. C'est alors qu'on peut s'amuser avec ses créatures.
Deuxième chose, sur le recul dont je parlais:
L'écrivaine Joyce Carol Oates a expliqué dans une interview qu'elle écrivait d'abord ses textes ( y travaillant avec acharnement comme toi et moi, je suppose)
puisqu'elle les laissait reposer ensuite un an sans les relire
"le temps de s'en détacher affectivement" (je cite ses mots).
Elle pouvait ensuite, j'imagine, en faire une lecture à la fois objective et technique.
Un luxe d'écrivain accompli que nous n'avons malheureusement pas le temps de nous permettre.
Voilà, quant à tes corrections, ça me parait bien pour autant que je puisse en juger. Le nouveau titre est mieux, aussi.
Bonne chance pour le concours, donc.
On se tient au courant, à bientôt.
*
Voilà, en guise de leçon - .
Leçon qui a aussi le mérite d'éclaircir les idées de son auteur.
Demain, d'autres éléments sur ce mode.
Une façon de faire un (auto)portrait dans le texte.
dimanche, mai 28, 2006
par DANIEL FRANCO, le dimanche 28 mai 2006
Dimanche , j'écris samedi. "La boucle est bouclée", voilà, par ailleurs, c'est le nom de salon que je proposerai à mon ami Laurent, coiffeur pour dames de son état. Avant-hier, je crois bien, à Cannes, a été présenté le film de Guillaume Malandrin : "Et qu'est-ce que ça peut me faire si demain n'arrive jamais". C'est bien ça, c'est pour ça qu'il faut écrire la veille pour le lendemain. Et surtout, si je dois finir par vendre la mèche, il faut écrire la veille pour continuer à se blottir tout contre l'avant-veille. C'est là, en effet, là où tout peut vaciller sans danger, dans l'antériorité, que la mèche est allumée, et si on veut la vendre, sagesse de boutiquier, il faut bien qu'elle soit à portée de main. Le palindrome, la préhistoire, le pathos antiquaire juif, les crampes scolaires de l'enfance, le seul filigrane qui serpente à travers ces petits billets, c'est ce cheminement en crabe, qui derrière la façade craintive, abrite la joie d'aller à reculons. Dans les contes de l'enfance, les femmes, reines et sorcières, vérifient leur beauté dans un miroir. Il en va de même de l'évolution, elle ne peut être magnifiée que dans cette translation géométrique. La topographie de la grâce : faire demi-tour. Platon disait que toute connaissance n'est que ressouvenir, c'est à dire qu'elle est de la nature du regret. Que regrette-t-on par le savoir ? On regrette la vie, qui cesse d'être miraculée, et n'est plus que cette négociation juteuse, ce jeu dont on tient toutes les ficelles. Ce que raconte la mythologie, c'est que toute expérience, dans son instauration, est mortelle. Souvenez-vous : les amours d'enfance, les toutes premières hontes, le premier mensonge réellement prémédité avec sa montée de sang au visage. Rien de tout cela à quoi on croyait pouvoir survivre. Apprendre, c'est d'abord amenuiser ce péril de l'expérience ordinaire, et par la suite, comme disait Salomon, en roi aux mains vides, la puissance creuse l'impuissance, la sagesse revient comme douleur. C'était aussi le programme de Heinrich von Kleist, dans son texte sur le Théâtre de marionnettes : regagner le paradis par la porte dérobée. En vérité, la tortue est cousue dans le dos du lièvre, c'est pourquoi le lièvre même en pleine course ne la rattrapera pas. Comprenez-vous ? J'attends, j'attendrai toujours ce thé, ce thé, ce thé en suspension dans l'air, ma mère a beau souffler dessus, il est encore trop chaud, encore un peu trop chaud, et c'est parce que je l'ai malgré tout porté à mes lèvres que je me trouve comme l'enfant Moïse, lourd de la lèvre, et perdu dans un désert, dans lequel je ne cesse d'errer à reculons, et ainsi, comment voulez-vous, quelle maigre chance ai-je donc d'arriver en terre promise ? Là où paraît-il, le lait, à flots, lui aussi, dans ma tasse de thé, doit venir couper la dominante de miel. D'ici là, de fleur en fleur, bagué de jour et nuit, une espèce de danse en guise de langage, aux ordres de la reine, je poursuis une existence bourdonnante, dévouée.
par DANIEL FRANCO, le samedi 27 mai 206
Il fait nuit, et pire que ça, c'est l'heure de l'échange, la pénombre n'est plus que ce banc de poissons aux écailles noires, assaillis par ce dais d'œufs blancs qu'ils viennent de pondre. C'est l'heure transitionnelle, pas le moindre bruit, le monde entier recouvre son état natif de peinture, avant d'être précipité à nouveau dans la rigueur photographique fourmillant de détails, puis, dans sa vérité cinématographique, quand la densité des figures devient sonore. La véritable origine du cinéma, c'est l'orage, avec le décalage entre la lumière et le bruit. Beauté des duels à mort, dans les films western. Le héros n'est pas celui qui tire plus vite que son adversaire, mais celui qui défie la rapidité de la bande-son. Tant que le film est muet, le mort reste débout, il ne peut pas s'effondrer, parce que l'image est l'élément de la résurrection. C'est pourquoi le christianisme, malgré la querelle byzantine des icônes, ne pouvait aboutir qu'à cette débauche de peintures, et passer le relais à l'institution du musée. Le judaïsme est une religion sonore, et son prophète Moïse, en mettant en bouche le charbon ardent, instaure par le bégaiement un éternel retour de la parole. Le bègue, tandis qu'il parle, souffle aussi, il souffle sur ses mots pour les éteindre, ou peut-être pour attiser en eux ce feu étrange qui les fait crépiter, mais ne les consume pas. Paul Celan, dans « l'Entretien dans la montagne » : « Le silence se fit donc, le silence, là-haut dans la montagne. Mais le silence ne dura pas longtemps, car lorsque le Juif s'en vient et en rencontre un autre, c'en est bientôt fini du silence, même dans la montagne. Car le Juif et la nature, cela fait deux, encore maintenant, même aujourd'hui, même ici. Les voici donc, les deux cousins, à gauche fleurit le martagon, fleurit sauvage, fleurit comme nulle part ailleurs, et à droite s'élève la raiponce ; et Dianthus superbus, l'œillet splendide, se dresse non loin de là. Mais eux, les cousins, Dieu leur pardonne, ils n'ont pas d'yeux. Ou plus exactement : ils ont, eux aussi, des yeux, mais un voile est tendu devant, non, non pas devant, derrière, un voile qui bouge ; aussitôt qu'une image y pénètre, elle se prend dans l'étoffe, et déjà un fil apparaît, qui se déroule et s'enroule autour de l'image, un fil du voile ; il s'enroule autour de l'image et engendre avec elle un enfant, mi-image et mi-voile. Pauvre martagon, pauvre raiponce ! » (éditions Verdier 2001, traduction Stéphane Mosès)
vendredi, mai 26, 2006
par DANIEL FRANCO, le vendredi 26 mai 2006
Vendredi, j'écris jeudi, comme disait Umberto Eco, dans l'île du jour d'avant. La sensation, de plus en plus, que j'ouvre un troisième poumon dans mon dos, et que c'est ainsi, la main tendue vers le révolu, et non pas la révolution, que je recouvre le goût de l'air. On ne devrait s'exprimer que comme ça : Le Révolu français, le Révolu bolchévique, et même, Le Révolu permanent. La notion de virtualité, de potentiel enfoui, la mèche providentielle qui se réserve à qui saura l'allumer, et ces intellectuels qui, à la manière des jeunes chats, grattent leur litière dans le mauvais sens. Aujourd'hui, avec la notion d'altermondialisme, la langue leur fait ce cadeau, aux jeunes chats, la vérité elle-même se déclare, comme une langue donnée aux chats. Altermondialisme allude à l'idée d'un autre monde. Les cellules nombreuses qui se regroupent en vertu de cet étendard, un indéfini absolu, se sussurent leurs intuitions vivaces. Tout ce pressentiment vertueux, mondialisé, qui compte les jours, cumule les observations à travers le monocle-mantra, et cependant cet anneau qui tourne n'est jamais que celui dont Nietzsche avait retrouvé le verbe, le revenir, et la substance, le même. Depuis toujours, pour moi, "autre monde" signifiait le monde dans lequel s'en vont les morts, ou pour les plus jeunes que le mot heurterait, c'étaient ceux qui "ont déménagé très loin" ou ceux qui sont partis pour de "longues vacances". Feuilleter les milliers de clichés d'Indiens d'Amérique du Nord d'Edward Curtis. Ou "Un monde disparu", de Roman Vishniac. Et soudain tout est clair. Ce monde autre que les altermondialistes appellent de leurs voeux n'a cessé d'être là, d'être blotti tout contre ce monde-ci, et chaque fois, en vertu de sa minorité, de sa proximité indéchiffrable, il a fait l'objet de récusations, d'amendements, de restrictions, et au bout du compte, le plus souvent d'exterminations concluantes. L'autre monde n'est pas celui que promet la Révolution, il est celui que ne cesse de réserver le Révolu, comme un soleil crépusculaire glissé dans un étui opaque, et comme l'enfance elle-même qui ne pouvait venir frapper les oreilles de Proust qu'à travers des parois tapissées de liège. Pour avoir le sens du devenir, rien ne sert d'avoir le nez collé sur ce présent-et-demi, dont l'excroissance de clarté n'est jamais que l'inversion de l'ombre portée qui ouvre un espace de fraîcheur à ceux qui nous ont devancés, et que nous ne voyons plus parce qu'à la différence de l'ange nouveau de Paul Klee, nous vivons la tête tournée dans le mauvais sens. Ce matin, me suis réveillé après avoir vendu, aux côtés de N., de minuscules barquettes de glace, des sachets de bonbons et des bougies. Toutes choses destinées à fondre, dans la main, dans la bouche, ou sur son séant, sous une petite frimousse de feu. A l'imitation de la mèche, progressivement rentrer la tête dans les épaules, et libérer le panorama à ceux qui sont derrière, sait-on jamais, au cas où leurs yeux ne sont pas clos, ou pas tout le temps, et qu'ils puissent ainsi les refermer, claire et distincte, au terme de cette pleine consolation.
jeudi, mai 25, 2006
par DANIEL FRANCO, le jeudi 25 mai 2006
Suite. Randonner sur une ligne brisée, et chaque jour, les cheveux dans le vent, entendre la foi sauter comme un bouchon, ou tinter au sol, comme une monnaie de plus en plus légère, et si c'est dans le sable, ne même plus percevoir le cliquetis que font en se déboîtant les arêtes du logos, du lien entre toutes choses. Aujourd'hui Amel a été interrogée, pour son examen de philosophie, sur philia et neikos chez Empédocle. La grande chaîne des êtres, et ensuite, par quelque retournement dont les sages avaient l'intuition contenue, l'inéluctable dissolution, et comme si chaque liaison, chaque concorde et chaque amour, étaient depuis toujours à quai, sur le point de suivre les rails taillés dans une sorte de matière de l'adieu. J'ai assisté aujourd'hui à un forum sur la question du beau dans les disciplines de l'art numérique. Les termes, la nature du débat, curieusement désuets, et rudimentaires, comme si dans la machine habitait l'intellect mûr devant lequel les humains étaient gratifiés d'un retour innocent à leur première enfance. La trompe de la machine, qui barrit vers l'absolu, nous la chérissons à rebours, comme toboggan. La nature hybride de l'humain a plus ou moins toujours été conçue comme une interface mystérieuse, la niche où viennent se replier les deux ailes incommensurables de la matière et de l'esprit, de l'animal et du dieu. C'est parce que ce mélange est foncièrement déraisonnable, que son intelligibilité ne pouvait être que fabulée, reconduite, différée, et cette fuite en avant portait le nom d'Histoire. Depuis que l'Histoire est close, la ligne d'horizon qui séparait les massifs de l'animal et du divin s'est considérablement brouillée. Le Dieu signifiait la perfection dans un passé absolu. Dieu étant mort, il emporte avec lui toute perfection, il la séquestre dans un temps qui en plus d'être révolu, est à présent résorbé. La machine en tant que construction infinie, renvoie l'idée de perfection dans un futur absolu. D'où cette bigoterie hystérique devant les écrans et les délinéaments des câbles, en tout point similaire à celle qui suintait depuis les paroisses. Satanés syllogismes. Demain je parlerai de l'autre monde. Je vous embrasse, ô mes frères chagrins, en vitesse, sur cette patinoire mitée - le temps?.
mercredi, mai 24, 2006
par DANIEL FRANCO, le mercredi 24 mai 2006
Une lettre ouverte, en somme, quand je ne rêve que de mutisme, les lèvres du baiser en poinçon dans la cire du roi, cette fin du monde toute blanche par-dessus, et noire par-dessous, simplement une grande feuille de papier se referme sur le monde, et sans rien détruire, par le tapissage uniforme de l'ombre, plonge tout ce qui vit dans un grand sommeil. Après avoir vu Palindromes, de Todd Solondz, durablement égratigné, ces corps dissemblables traversant le nom, Aviva, qui est devenu chambre d'essayage, et en en sortant, y retournent, en vertu de sa nature palindromique. Et autre chose, que je ne conçois pas clairement, mais qui tient dans cette scène d'ouverture de funérailles juives, quasiment silencieuses, comme une prise d'apnée avant que l'éternel retour du palindrome soit même amorcé. J'essaie de faire traduire, par Jean Torrent, le livre de Vilem Flusser intitulé "Jude sein". Le nom juif apposé devant le numineux lexème heideggerien, comme je l'ai écrit à Pierre, c'est les trompettes de Jéricho dans les mains d'un enfant. Un jeu de pipo, ou de pilpoul, pour mettre à bas le temple qui fonde. Acheté hier, à l'occasion de l'anniversaire de A., le récent 'Pork and milk' de Valérie Mréjen ainsi qu'une anthologie de poèmes et de proses de Avot Yeshurun. Valérie Mréjen essaie de démontrer que l'absence de foi, ou la perte de la foi, elle aussi, peut prendre les traits d'une révélation. Une femme interrogée, explique que la confirmation lui est venue sur la plage de Tel-Aviv, lorsque le vent à soufflé dans ses cheveux dévoilés et défaits. Le film documentaire, inséré dans le livre, est comme un vent qui ne soufflerait pas. Platitude extrême de l'enregistrement sociologique. La femme de Loth se retourne sur ce qu'elle n'est pas, ou sur ce qu'elle n'est plus. Elle devient statue de sel. Mais à l'instar du divin cycéon d'après Héraclite, afin qu'elle délivre sa saveur, même la salière a besoin d'être secouée. Me revient en mémoire la phrase initiale du Bruit de Saint-Georges, roman inachevé, inachevable, comme tout ce que la douleur inspire à la jeunesse : " L'avion traversait indifféremment les chaînes de nuages, tout comme aux blanches parturientes, l'adieu filant d'un enfant de métal."
mardi, mai 23, 2006
par DANIEL FRANCO, le mardi 23 mai 2006
J'ai lu le journal, Libération, à l'affût d'une larve que j'aurais pu chauffer dans mes mains et faire éclore le soir. Tremper l'insecte dans l'encrier et rédiger ma page de blog, littéralement, avec des pattes de mouche. Je n'ai rien trouvé, rien qui soit blanc, laiteux, un peu suintant, et dans ce gras pelliculaire, trahisse une entéléchie dans la hâte de venir au jour. Peter Handke a écrit un long texte dans lequel il prend résolument son envol de corneille serbo-croassante. Il cite les citations qu'on fait de lui, qu'il soumet à l'ordalie de la source auctorale, "oui ça je l'ai dit, mais ça non, je ne l'ai jamais dit". Il était déjà parole d'évangile, il manquait l'appareil critique pour figurer parmi les saints dans la bibliothèque des sciences religieuses de l'EHESS. Evidemment, comme de nombreuses polémiques, celle-là écoeure dès le matin, en vertu de l'adage catoptrique : l'homme est une loupe pour l'homme. Handqueue, Handqueue, mais est-ce que Bozonnet a le droit de dé-programmer la pièce de Handqueue ? Voilà, toute la Yougoslavie est sauve, les morts sont ressuscités et entrent dans la gigue à la handqueue leu leu. Un artiste, dont le nom m'échappe, m'avait fait part d'une idée prodigieuse : mettre en scène le corps disloqué d'Icare, dont ne subsiste que la bouche, enflée, devenue prodigieusement bavarde. Mc Luhan avait élaboré une théorie ingénieuse sur l'emboîtement des médias : un medium a pour contenu un medium antérieur. Un film, par exemple, a pour contenu le médium de l'écriture (scénario ou roman), lequel à son tour à pour contenu le médium de la parole. Aujourd'hui, le DVD, avec son appareillage à entrées multiples, ses suppléments didactiques, à pour contenu le médium du film. Le problème, c'est qu'à un moment, le passage au niveau supérieur ne donne lieu à aucune différence formelle. Il n'y a pas de médium qui puisse se donner pour contenu le médium DVD. Seule la parole peut continuer à passer la tête, quelle que soit la hauteur d'enveloppement atteinte par le médium ultime. C'est pourquoi le jugement continue de se faire dans le cadre antique du tribunal, et dans une langue qui semble exemptée de toute mise à jour. L'espace juridique est l'espace dans lequel viennent au monde les plis nouveaux affectés à la défiguration du présent. Le palais de justice est l'équivalent volumique de la toile plane sur laquelle figure le portrait envouté de Dorian Gray. Bref, au terme du processus, il ne reste à la parole, après avoir traversé et surmonté l'architectonique des médiations, qu'à se faire face, comme Dorian Gray devant son tableau, le visage vivant et inentamé devant la réplique odieuse, et dont la laideur finalement n'est que ceci : l'archive simultanée de toutes ses épreuves.
lundi, mai 22, 2006
par DANIEL FRANCO, le lundi 22 mai 2006
Dimanche, j'écris pour lundi. Comme au temps de l'école, la veille au soir est un estomac noué dans le temps. Je pose sur la feuille mon nez raccourci, mon enfance me prend à la gorge, comme une brumisation de camphre. Je crois bien que je saute la marelle de l'évolution à rebours, comme le blizzard sur l'ange de Benjamin, le progrès est une poussée odieuse dans mes ailes, et tout mon arrière-train porte la vertu lourdaude du refuznik, ou dans le langage nietzschéen, la sainteté du chameau. Bientôt un citron émergera du néant, des doigts en presseront ce qu'il faut pour couper la dominante de miel, un thé, un thé, un thé flottera dans l'air, dont les volutes peu à peu se fraieront une voie dans le contour et ce sera la bouche de ma mère, qu'une ligne divisera pour séparer les lèvres avec lesquelles elle soufflera dessus la bonne température. Ou bien je rêve, ce n'était que ce sourire, qui est perché sur mon épaule, depuis que j'ai erré loin de mon chat. Je parlerais volontiers de la politique, du temps présent. Mais il n'y a pas de politique le dimanche. Les journaux se taisent, la machine pénitentiaire est en train de graver dans le dos du papier le crime qui s'est fait sous les yeux, au vu de tous. Ce sera l'occasion de rougir, de honte, ou de soulagement, sait-on jamais dans le dortoir des manchots et des impuissants, lequel branle l'autre. Dans chaque chose ronde, nous cherchons le centre, au lieu de suivre le rayon. Le cosmos était un infini, dont la terre était le centre. La terre était une étendue bariolée, dont l'homme était le recenseur. L'homme était une nature hybride, dont le génome a promu la miniature niaise, crochetée, la double hélice au pays des merveilles. Il reste à élire la poignée de gènes réellement décisifs, la combinaison protéïnée des arts et métiers. Et puis le dimanche éternel, celui qui sait nouer jusqu'au filament de la trotteuse sur une seconde qui se mordille le bouton de queue. Il est minuit passé quinze minutes. Le Sauveur, à moto, la grande frite à l'air, top sucré, vient de passer sous ma fenêtre.
par ALEXANDRE CAUSIN, le dimanche 21 mai 2006
Journée d’Usine. (Travailler le dimanche, c’est l’avenir…).
Je rentre vers sept heures et ressort immédiatement dériver dans le vent. Je passe le pont du canal, à hauteur du beau Kaai Theater, et m’enfonce dans Molenbeek.

Quartier malfamé d’après certains n’hésitant pas à se proclamer « Bruxellois de souche » (C’est-à-dire : « pur, blanc, belge, antécédents familiaux dans les colonies appréciés »). Quand j’entends ça, j’ai envie de cogner. C’est juste pauvre, moche et marocain. Des petits immeubles sans style, amochis de surcroît par des rénovations tout PVC.
Une façade à l’angle des rues du Maroquain (sic), de l’Avenir, et de la Prospérité !

C’est étonnant le soin que l’on a pris pour obstruer proprement les fenêtres de cette ancienne fabrique, afin de la rendre inhabitable. Du sérieux avec lequel on organise l’oppression et la misère.
Je fais du Godard :

L’expo de Beaubourg est réjouissante. Elle fait un peu de remous dans les journaux. Très peu, les articles prévus, forcément fleuves et nécrologiques, ont dû être remplacés par quelques entrefilets dépités. « De qui se moque-t-on – Les inrocks titrent : Le mépris – Le « génie » – désormais les guillemets et la minuscule s’imposent – ne serait-il pas en train de se foutre de notre gueule, nous qui défendons à corps perdus et à longueur d’année les grandes messes commémoratives ? »A la poubelle, catalogues d’expo, suppléments quadrichromiques, produits dérivés. On remballe les gaules. Bravo mon Jean-Luc, tu ne t’es pas laissé enterrer vivant.
Je rentre vers sept heures et ressort immédiatement dériver dans le vent. Je passe le pont du canal, à hauteur du beau Kaai Theater, et m’enfonce dans Molenbeek.

Quartier malfamé d’après certains n’hésitant pas à se proclamer « Bruxellois de souche » (C’est-à-dire : « pur, blanc, belge, antécédents familiaux dans les colonies appréciés »). Quand j’entends ça, j’ai envie de cogner. C’est juste pauvre, moche et marocain. Des petits immeubles sans style, amochis de surcroît par des rénovations tout PVC.
Une façade à l’angle des rues du Maroquain (sic), de l’Avenir, et de la Prospérité !

C’est étonnant le soin que l’on a pris pour obstruer proprement les fenêtres de cette ancienne fabrique, afin de la rendre inhabitable. Du sérieux avec lequel on organise l’oppression et la misère.
Je fais du Godard :

L’expo de Beaubourg est réjouissante. Elle fait un peu de remous dans les journaux. Très peu, les articles prévus, forcément fleuves et nécrologiques, ont dû être remplacés par quelques entrefilets dépités. « De qui se moque-t-on – Les inrocks titrent : Le mépris – Le « génie » – désormais les guillemets et la minuscule s’imposent – ne serait-il pas en train de se foutre de notre gueule, nous qui défendons à corps perdus et à longueur d’année les grandes messes commémoratives ? »A la poubelle, catalogues d’expo, suppléments quadrichromiques, produits dérivés. On remballe les gaules. Bravo mon Jean-Luc, tu ne t’es pas laissé enterrer vivant.
samedi, mai 20, 2006
par ALEXANDRE CAUSIN, le samedi 20 mars 2006

Je n’ai rien à dire. Je me prends en photo pour passer le temps. Flemme à raconter. Il faut dire que mon journal de Kristeva (Libération d’aujourd’hui) est à vous dégoûter de cette forme à jamais. On apprend avec beaucoup de joie qu’elle prend un plaisir inouï à regarder le football avec son Philippe… J’en frémis de les imaginer, vautrés, commentant les dribles métaphysiques des durs du mollet…
Je jette simplement quelques mots qui ont habité ce jour : Gabrielle Wittkopp, Marco Ferreri, Chloé, Ferdinand, Etterbeek, Aline, John, Benoît, Sindibad, Modem, Table basse, JLG, Sébastien Tellier, Walter Benjamin, Le Portique, Dominique Thirion, Dominique Fellmann, Yambula.
Au lit !
vendredi, mai 19, 2006
par ALEXANDRE CAUSIN, le jeudi 18 mai 2006
2 heures. Réveillé par un énorme orage. Le quartier est plongé dans le noir, l’électricité a sauté.

(«Combat de nègres dans une ruelle sombre, la nuit». Alphonse Allais, le véritable inventeur du monochrome)
Usine, de 10h30 à 19h.
« Attendu qu’il est notoire que la grande majorité des gens travaille ; et que ledit travail est imposé à la quasi-totalité de ces travailleurs, en dépit de leurs plus vives répulsions, par une écrasante contrainte » (Debord),qu’est-ce que je fous là ?


(«Combat de nègres dans une ruelle sombre, la nuit». Alphonse Allais, le véritable inventeur du monochrome)
Usine, de 10h30 à 19h.
« Attendu qu’il est notoire que la grande majorité des gens travaille ; et que ledit travail est imposé à la quasi-totalité de ces travailleurs, en dépit de leurs plus vives répulsions, par une écrasante contrainte » (Debord),qu’est-ce que je fous là ?


Nous dînons d’un stoemp–cabillaud parfait, en compagnie de Michelle Van B., de Laurent Thurin et d’un ecclésiastique, Emilion. Ce dernier est de très bonne compagnie, passionnant, fort drôle, nous sommes tous suspendus à ses lèvres. Il est rapidement rejoint par quelques amis venus de Champagne et de la vallée du Rhône.
mercredi, mai 17, 2006
par ALEXANDRE CAUSIN, le mercredi 17 mai 2006
7h03, réveillé brutalement, à nouveau, par les forçats du béton. J’ai du temps devant moi avant l’usine et décide de passer au consulat de France pour régler les problèmes d’état civil de Ferdinand. Il ne peut décemment pas rester dans son état actuel de Belgitude exclusive. Il sera donc Belgo-Franco-Italien. C’est peut-être inutile et un peu ridicule, mais j’espère qu’il aura ainsi moins de chance de devenir un de ces odieux supporter de foot. «Allez les bleus », « Allez les diables », « Forza Azzurri », quels cons. C’est la seule chose qu’ils sont foutus de se rappeler de leur « être » national. Imagine-t-on des « Lisez Honoré (Balzac) ! Ecoutez Dante (Alighieri) ! Admirez James (Ensor) » ? Alors évidemment, après c’est facile de dire : « La nation, c’est idiot, regardez ces cons de supporters se foutant sur la gueule ». La nation, c’est la langue. Et la langue c’est tout. Godard, par exemple, diriez-vous qu’il est suisse ? Non, parce que la Suisse n’est qu’un conglomérat de banques sans langue. (Un peu comme l’Europe à laquelle on a dit non, pour un temps). Le « plus con des suisses pro-chinois » est Français. Après, vous pouvez vous prétendre « citoyen du monde », si vous n’avez pas peur du ridicule.
Matinée très française donc, consulat, puis café sur la belle place de la Liberté (c’est étonnant une place de la Liberté dans un pays qui n’a pas coupé la tête au monarque), Libération – rien d’autre qu’un bon Skorecki, comme d’habitude –, une Gitanes internationale, une touriste française cherchant à photographier des maisons Art nouveau et qui me demande pourquoi les façades verticales apparaissent horizontalement sur son appareil numérique. Je m’aperçois rapidement qu’elle est folle et me sauve à la première occasion.

Après ça, blackout entre 10 h 30 et 19 h. (usine, en roue libre).
Je rentre en passant par le beau Quai du Commerce et son allée d’arbres. Je pense à Baudelaire, qui s’était tant déplu à Bruxelles : « Des balcons partout, personne aux balcons ». Quai du Commerce, pas de commerces. Des arbres qui donnent envie de paresser à l’ombre, pas de bancs...

Fameux roti de porc.
Vin blanc de Vénétie et d’excellentes Gitanes au dessert.
Matinée très française donc, consulat, puis café sur la belle place de la Liberté (c’est étonnant une place de la Liberté dans un pays qui n’a pas coupé la tête au monarque), Libération – rien d’autre qu’un bon Skorecki, comme d’habitude –, une Gitanes internationale, une touriste française cherchant à photographier des maisons Art nouveau et qui me demande pourquoi les façades verticales apparaissent horizontalement sur son appareil numérique. Je m’aperçois rapidement qu’elle est folle et me sauve à la première occasion.

Après ça, blackout entre 10 h 30 et 19 h. (usine, en roue libre).
Je rentre en passant par le beau Quai du Commerce et son allée d’arbres. Je pense à Baudelaire, qui s’était tant déplu à Bruxelles : « Des balcons partout, personne aux balcons ». Quai du Commerce, pas de commerces. Des arbres qui donnent envie de paresser à l’ombre, pas de bancs...

Fameux roti de porc.
Vin blanc de Vénétie et d’excellentes Gitanes au dessert.
par ALEXANDRE CAUSIN, le mardi 16 mai 2006
Après une moche nuit de sommeil interrompue à plusieurs reprises par les revendications de Ferdinand – je renonce à contextualiser : qui est Ferdinand ? où vis-je ? quel est mon âge ? quels revenus ? ségolène ou françois ? J’écris comme si vous connaissiez tout de mes antécédents. J’écris comme si j’étais une de ces vedettes du samedi dans Libération, sauf que je ne dis pas : « ô quel malheur les tchétchènes israël la pollution la pauvreté les banlieues le métro c’est-à-dire la misère toujours ailleurs « moi je vais bien merci je suis écrivain ». C’est étonnant comme c’est toujours mauvais, avez-vous remarqué ? – à sept heures du matin, débarquent quatre maçons flamands armés de poutrelles en béton armé. Ils sont là pour couler une dalle dans la cage d’escalier. J’ai des soucis de propriétaire, c’est lamentable. « Posséder un tapis, c’est déjà trop », disait Jack. Il avait sans nul doute raison, mais j’ai toujours fait preuve d’une grande couardise lorsqu’il s’agissait de se confronter aux rudesses de la belle étoile. Un autre disait : « La propriété, c’est pas seulement le vol, c’est aussi le crime ». Très juste ! « Exproprions, exproprions, les salauds cornichons », comme dirait le plus grand de tous les Belges.
Les brutes commencent leur travail de démolition, les scies hurlent, Ferdinand aussi. Sa mère le mène dans les quartiers les plus paisibles de l’ambassade. Il se calme.

Par la suite, la journée consiste à surveiller les travaux. « Mon cher, je suis éreinté, je suis en plein travaux, j’ai des ouvriers à la maison ! ». Ça m’angoisse parce que je ne sais pas y faire. Je laisse ces forcenés amocher la rampe d’escalier, rayer les marches sans mot dire. J’ai des vapeurs de prolétaire. « Les pauvres, ils font un métier si difficile… ».
L’après-midi, je me paye des charentaises au « palais de la pantoufle », rentre très fier et les enfile illico. Je vais bien.
A la tombée de la nuit, il pleut.

Les brutes commencent leur travail de démolition, les scies hurlent, Ferdinand aussi. Sa mère le mène dans les quartiers les plus paisibles de l’ambassade. Il se calme.

Par la suite, la journée consiste à surveiller les travaux. « Mon cher, je suis éreinté, je suis en plein travaux, j’ai des ouvriers à la maison ! ». Ça m’angoisse parce que je ne sais pas y faire. Je laisse ces forcenés amocher la rampe d’escalier, rayer les marches sans mot dire. J’ai des vapeurs de prolétaire. « Les pauvres, ils font un métier si difficile… ».
L’après-midi, je me paye des charentaises au « palais de la pantoufle », rentre très fier et les enfile illico. Je vais bien.
A la tombée de la nuit, il pleut.

mardi, mai 16, 2006
dimanche, mai 14, 2006
par LAURENT HERROU, le dimanche 14 mai 2006

Couché à quatre heures du matin, pleine lune. Pierre dit : Jésus rencontrait Bouddha la nuit dernière. Il a dîné avec des gens branchés ésotérisme, il nous annonce l’événement qui faisait date pour les âmes occultes. Il dit : la lune était bleue. J’ai allumé le portable, il y avait des décisions à prendre. La lumière entrait par la fenêtre, un phare blanc braqué sur mon écriture. Les étoiles se multipliaient sur la trame voilée du rideau transparent, je n’ai eu besoin que de quelques lignes pour prendre ma décision. Je ne me punis pas, je m’épargne. Il était deux heures du matin, peut-être moins, j’ai perdu le fil des heures, le casque sur les oreilles, en écoutant de la daube, Mylène Farmer remixée, Dido, Beyoncé. La silhouette hirsute de Jean-Pierre s’est interposée au milieu de la nuit : tu ne dors pas? Et : qu’est-ce que j’ai eu peur… Le silence, musique dans les oreilles. Il est retourné ronfler tandis que je m’abîmais dans le visionnage des deux premiers épisodes de “24”. Nina Myers. Ne pas oublier que c’est Gilles qui. Rendre à César.
J’ai rêvé des toits italiens, lumière orangée sur les ardoises rouges. Le crépuscule avait été splendide, Jean-Pierre prenait des photos à bout de bras à travers le vasistas de la chambre, puis mes cheveux relevés sur le crâne, serrés dans mon poing sous la clarté surnaturelle.
Jésus rencontre Bouddha.
Je me tournais, me retournais dans le lit, incapable de trouver le sommeil. J’ai rêvé de l’Italie, plus tard, un vieil homme me montrait sa chambre de bonne, fier de la vue inattendue. Les toits de Rome, les dômes. Au loin, une mer noyée dans la brume. L’homme disparaissait dans ma vision, il n’y avait plus que le paysage qui comptait -à l’image de la photo que Jean-Pierre a choisie pour la note d’hier sur le blog. L’homme ne compte pas.
Les hommes ne comptent pas.
Restent les mots.
copyright laurent herrou photo/jean pierre paringaux
samedi, mai 13, 2006
par LAURENT HERROU, le samedi 13 mai 2006

Dîné à la Table du Maroc avec Joëlle et Thierry et si j’avais prévu de ne pas boire de vin, histoire de ne pas aggraver ma situation hépatique, je me suis quand même laissé tenter par un Boulaouane gris qui a emmené la viande des brochettes avec fraîcheur et légèreté, colmatant ainsi le vide créé par la cuite de la veille. On a terminé vers minuit et demie en éclats de rire convulsifs, Thierry a dit : je ne me lâche pas encore complètement, on ne se connaît pas assez… Jean-Pierre a demandé ce que ce serait alors. On s’est donné rendez-vous à une prochaine fois, chez nous ou chez eux, les premiers pas de l’amitié -c’est toujours étonnant, les premières fois : les questions que l’on répète, on n’avait pas fait gaffe à la première demande, on n’avait pas retenu la réponse, on se disait que l’information ne servirait pas; au second questionnement, le cerveau enregistre, il ne s’agirait pas de faire une bourde à ce stade balbutiant de la relation. Thomas était resté avec sa grand-mère, c’était donc la première fois que nous nous retrouvions ensemble, tous les quatre, entre adultes. Lors du voyage au Maroc, Thomas avait fait le lien, c’est lui qui nous interpelait, petite main qui s’agitait en tout sens dès qu’il nous apercevait, coucou, les copains! Etrange ressemblance entre la mère et l’enfant, le visage ouvert et curieux de Thomas, en présence de ses parents, n’évoquait pas la parenté, mais absent, l’enfant se retrouve sur les traits de Joëlle, dans ses étonnements soudains, presque naïfs. Thierry de son côté sourit, et l’adulte fond dans l’expression espiègle, amusée, prête au bon mot, aiguisée. Jean-Pierre a rappelé que nous nous étions croisés au concert de M83, il y a quelques années, Thierry était surpris : mais on s’était parlé…?
On s’est couché vers une heure du matin, satisfaits, après un passage bref sur le blog et les mails.
Samedi.
Le week-end, sans obligation -de mon côté en tout cas, Jean-Pierre est en route vers ses parents. Le journal en milieu de matinée, plus tard que d’habitude. On a acheté Libé, nouveau magazine au sein de ses pages, Ecrans, internet, télévision, vidéo et cinéma. J’ai feuilleté les pages à la recherche d’une mention, conformément à mon égocentrisme assumé. Mais non -pas encore. J’ai acheté les DVD des clips de Tori Amos, “Fade to red”, et finalement trois livres : “Ferdière, psychiatre d’Antonin Artaud” d’Emmanuel Venet; “Autobiographie d’Alice Toklas” de Gertrude Stein; et le “Voyage au Maroc” d’Edith Wharton -étrangement, j’y reviens sans cesse. J’ai emporté “Le monde désert” de Jouve au café, son écriture moderne, iconoclaste.
Jean-Pierre est parti et la matinée s’étire devant moi, vierge, prometteuse.
copyright Laurent Herrou photo/Jean Pierre Paringaux
vendredi, mai 12, 2006
par LAURENT HERROU, le vendredi 12 mai 2006

Une bouteille de vin devant la télé, une pizza, un pot de glace. Une bouteille de vin que je bois seul, un Chinon 2004. Je me punis d’un crime que je n’ai pas commis, je lève les bras devant la Nouvelle Star, en cadence, encourage à voix haute, j’applaudis, au spectacle. Ivre. Le foie tient, c’est étonnant ce qu’il endure. Je me punis, je me fais du mal -ou du bien, c’est selon, j’oublie. Une bouteille de vin, Sandrine écrit : “tu m’inquiètes, ça va?” Je réponds non, mais qu’elle ne s’inquiète pas. Je ne vais pas bien, mais je ne vais pas pas bien, ce n’est pas moi qui ne vais pas bien, je ne vais pas bien dans le sens où, là, ce soir-là, devant la télé, plein volume, tant pis pour les voisins, j’assume M6, j’ai du mal à avaler. Devant le frigidaire, j’ai vomi l’eau gazeuse sur un morceau de bleu. J’ai toussé comme un malade, la main à la gorge, c’est là que j’ai compris qu’il me fallait le vin. La bouteille a suivi, logiquement.
Le journal serait faussé si je ne disais pas mon état d’esprit mais le journal sera faussé du fait que je ne dirai pas pourquoi. Ce n’est pas le lieu : le journal intime est le lieu de la confidence, le journal publié n’est pas le lieu de la délation. La publication biaise le médium, elle n’ampute pas l’écriture du fait que je choisis les mots que je livre. Je ne me censure pas dans la mesure où je sais ce que je fais. Ce n’est pas une mutilation, c’est un respect.
Le vin rouge, c’est un manque de respect par contre.
Je m’étends, la tête me tourne, dès que les yeux se ferment, la pièce (la perception de la pièce dans le noir) bascule, m’emporte dans un tourbillon nauséeux. Je ne vomirai plus néanmoins, je m’endormirai avec le vin en moi, 75 cl. de Chinon 2004 au fond des entrailles.
Le journal n’est faussé que si je n’accepte pas de jouer le jeu, le journal est faussé si je n’accepte pas l’idée que le journal publié, dans cet esprit de publication, dans cette attente, n’est pas le journal. Vous lisez ce que je vous donne à lire. Le journal, le journal de l’écrivain, est une main basse, un vol. Consenti, réclamé. Je n’écris pas le journal pour qu’il dorme avec moi dans la tombe. Mais je n’écris pas le journal pour que vous y laissiez traîner vos sales pattes.
Je vais mourir, mais vous mourrez aussi.
Je vais mourir, vous ne lirez pas le journal de Laurent Herrou. Ce sont d’autres qui s’en chargeront après vous. Longtemps après.
Je ne vais pas mourir maintenant, ne cherchez pas à m’enterrer.
copyright Laurent herrou photo/jean pierre paringaux
jeudi, mai 11, 2006
par LAURENT HERROU, le jeudi 11 mai 2006
Sur le chemin du restaurant hier midi, un exemplaire du “Nicolas Pages” de Dustan. Collection Le Rayon (encore) Gay, Balland. Le livre était posé sur l’étalage d’un antiquaire qui empiétait sur le trottoir, il dépassait sous un drap blanc, linceul, sa couverture pâle, cœur écorché en illustration, tournée vers moi. J’ai eu une hésitation, fallait-il que je le prenne? Je n’avais pas d’appareil photo à ma disposition, Sébastien, qui déjeunait avec moi, n’en avait pas non plus, je me suis contenté de ranger l’information et l’image saisissante dans un coin de ma tête. J’ai envoyé un mail à Michel hier soir pour lui dire que je serais à Paris du 20 au 23, que j’espérais le voir, rattraper les mois passés, le silence que j’incombais au manque de temps : on est parti au Maroc, j’ai été secoué par le voyage, plus que je ne l’admettais (perdu cinq kilos sur place), au retour on s’est remis, Jean-Pierre et moi, au blog, à la création, aux idées, à l’amour aussi, non pas qu’on l’avait mis de côté mais les mois s’additionnent, ils s’ajoutent les uns aux autres, étrangement différents, les sentiments évoluent, le rapport change si la base reste la même : une admiration mutuelle. Un gars disait du mariage hier soir à la télé qu’il représentait la fin des libertés, quelque chose que j’avais moi-même ressenti au début de la relation -même si, en vérité, je n’avais jamais été libre, à aucun moment dans ma vie. Après dix ans, il me semblait que la liberté s’installait paisiblement au contraire, une vraie liberté, celle d’être qui l’on est, profondément, celle de pouvoir se laisser aller à dire (sinon à faire) tout ce qui passait par la tête.
Ciel troublé, nuages blancs et fraîcheur, le soleil ne chauffe pas -si l’été pouvait ressembler à cette matinée (mais c’est un espoir impossible).
Je travaille à dix heures, je sors à cinq, vernissage à la Station, artistes canadiennes, trois femmes, puis soirée seul, à la maison, du temps pour internet, les blogs où à mon tour je ne dépose plus aucun commentaire, tout à mon propre travail, mon écriture. Sandrine a laissé un commentaire sur la dernière note, Alain aussi, l’un comme l’autre détournait le sujet, ne l’affrontait pas, ne le voyait peut-être pas ou du moins lisait autre chose (un cauchemar chez Sandrine et la mort chez Alain), je me suis demandé si mon écriture n’avait de sens que pour moi seul, je me suis demandé hier soir si le journal n’avait d’intérêt que pour son auteur, je veux dire : dans son contexte, en cours (je lis suffisamment de journaux d’écrivains pour y reconnaître un intérêt évident), le décalage entre la vie vécue et la vie écrite n’est-il pas nécessaire pour que tout ceci prenne un sens? En un mot, un journal n’a-t-il un intérêt que lorsque son auteur est mort?
Je ne lis pas Renaud Camus.
Je ne lis pas Marc-Edouard Nabe.
Je ne lis pas Matzneff.
J’ai lu Guibert dans les dix dernières années.
Je me triture la cervelle mais je crois que je ne lis pas de journaux d’écrivains vivants. Combien attendront ma mort pour me lire?
Dustan avait-il un journal?
9:00.
Une heure encore devant moi, la journée ne fait que commencer.
Vérifié sur mon exemplaire de "Nicolas Pages", le Rayon n'était déjà plus Gay.
copyright Laurent Herrou Photo/Jean Pierre Paringaux
mercredi, mai 10, 2006
par LAURENT HERROU, le mercredi 10 mai 2006
 Rêvé d’adultère. L’homme dormait dans notre lit, à la place de Jean-Pierre. Je ne me souvenais pas du plaisir, juste de la culpabilité à l’idée que Jean-Pierre allait bientôt rentrer, croiser l’homme, que j’allais le perdre. Il téléphonait, je chassais l’homme avec douceur de peur qu’il ne se rebelle, mon cœur battait. Jean-Pierre au réveil m’a demandé si j’avais bien dormi, je lui ai répondu que j’avais fait des cauchemars. J’avais ouvert les yeux sur son dos, sa nuque aux cheveux longs, emmêlés par la nuit, j’avais soufflé, soulagé -ainsi ce n’était pas réel, nous n’étions pas en danger. Jean-Pierre trouvait que ce n’était pas un cauchemar de rêver que je le trompais, j’ai répondu : chez moi, si. Je ne suis pas rentré dans les détails.
Rêvé d’adultère. L’homme dormait dans notre lit, à la place de Jean-Pierre. Je ne me souvenais pas du plaisir, juste de la culpabilité à l’idée que Jean-Pierre allait bientôt rentrer, croiser l’homme, que j’allais le perdre. Il téléphonait, je chassais l’homme avec douceur de peur qu’il ne se rebelle, mon cœur battait. Jean-Pierre au réveil m’a demandé si j’avais bien dormi, je lui ai répondu que j’avais fait des cauchemars. J’avais ouvert les yeux sur son dos, sa nuque aux cheveux longs, emmêlés par la nuit, j’avais soufflé, soulagé -ainsi ce n’était pas réel, nous n’étions pas en danger. Jean-Pierre trouvait que ce n’était pas un cauchemar de rêver que je le trompais, j’ai répondu : chez moi, si. Je ne suis pas rentré dans les détails. A propos de détails, sur la page d’identification de myspace.com, quelqu’un a spécifié que je ne voulais pas d’enfants dans la rubrique Kids, une phrase que je n’avais pas écrite. Je me suis dit que si n’importe qui pouvait écrire n’importe quoi à mon propos, il faudrait faire quelque chose. Je l’ai pris à la rigolade, j’ai ajouté une précision dans une rubrique plus en vue, disant que je n’étais pas responsable de la phrase et que si quelqu’un pouvait m’aider à la supprimer, je lui en saurais gré. Tout cela en anglais puisque myspace.com is an english space. It’s a fun space… a écrit Sophie dans un mail. Jusque là, oui.
Mercredi matin.
La douche en mèches mouillées dans le cou, Kate Bush dans la B&O. Menace d’orages, entendait-on sur France-Info ce matin. On a bu le café sur le boulevard après avoir acheté Libé, il y avait deux pages sur la Fnac, un article à propos des magasins de banlieue qui seraient, disait-on, plus chaleureux que les magasins en ville. Je n’ai pas encore lu, juste souri en entendant le résumé que m’en faisait Jean-Pierre. Il est parti travailler, je suis rentré à la maison, sans livre une fois de plus. Je ne lis pas, je ne lis plus. Aurélie m’a offert “Le monde désert” de Pierre Jean Jouve, son livre préféré, disait-elle. J’ai commencé dix titres en même temps, repris le journal de Nin, jamais terminé le Harper Lee, il y en a une pile qui m’attend à la Fnac, que je ne vais pas acheter maintenant, ça ne servirait à rien. Je ne lis pas, je n’écris pas. Je me consacre au blog, au journal, le reste n’avance pas, question de temps, peut-être. Une semaine de vacances à venir, encore une : du 18 au 26.
Cannes.
Paris.
On verra alors.
copyright Laurent Herrou photo/ Jean Pierre Paringaux
mardi, mai 09, 2006
par LAURENT HERROU, le mardi 9 mai 2006
Jean-Pierre demande : tu n’as pas pris de livre? Je travaille à 9h.30, d’ici là : le journal. Je dis : Gilles me donne l’occasion de renouer strictement avec ma discipline, Jean-Pierre sourit. Gilles a inséré une photo sur la page du 8 depuis notre blog, regard et boucle, on a frémi en lisant le mail qui l’annonçait, mais l’effet est très réussi et Jean-Pierre est d’avis que la photographie devrait ouvrir chacune des entrées, le point commun de la semaine. Je réponds que Gilles pense sûrement de la même façon. La confiance.
Ciel bleu superbe et fraîcheur matinale après le week-end gris.
On est descendu en ville, fait les magasins exceptionnellement ouverts en ce jour férié, Jean-Pierre voulait acheter une tondeuse pour barbe, la nôtre avait lâché samedi. Il m’a offert une paire de lunettes Police derrière lesquelles j’ai pu protéger mes yeux malmenés par la lumière dès la sortie des Galeries Lafayette. On a déjeuné dans un resto chinois, bu un café dans la Piétonne, on est passé devant le ciné, il n’y avait rien à cette heure-là. On est rentré à la maison, vers le blog, les mails, internet et les séries télévisées. Après une heure de ménage nécessaire, on s’est avachi devant la première saison de “Oz”. On avait vu “9m2 pour deux” la semaine dernière à l’Espace Magnan, une expérience conduite à la prison des Baumettes avec des détenus, le réalisateur employait des mots délirants pour qualifier son film, il avait reconstruit une cellule fictive au sein de l’établissement carcéral pour faire tourner les prisonniers, il leur avait appris à tenir une caméra, à fixer un point, à suivre une ligne, les basiques d’une école de cinéma, reprenait le présentateur. Ils en avaient tiré des saynettes ridiculement fausses où les hommes s’excusaient de faire trop de bruit et de déranger l’autre, jouaient au Scrabble pour passer le temps, s’encourageaient à tenir le coup, évoquaient en riant le parloir et coupaient la télévision sur un film porno, sinon, quoi, tu deviens fou, quoi! “Oz”, avec sa prison Space Enterprise et sa violence insoutenable, devenait presque réelle.
Je n’écris pas le journal, j’écris pour Gilles.
Lâche-toi, Laurent, tu n’écris pas ton journal, tu écris ce qu’on voudrait lire.
Tu ne te branles pas, matin, tu ne te branles pas, tu ne rejoins pas internet même si tu as ouvert les mails, tu as vu que tu avais des mails, tu ne les as pas lus, tu penses que la priorité, encore ce matin, c’est le journal publié, résultat : tu ne te fais pas confiance, tu n’écoutes pas la voix, tu ne laisses pas les doigts travailler, tu réfléchis et c’est mauvais.
Soleil sur un ciel bleu minable, la fraîcheur entre par la fenêtre du salon, une jambe repliée sous la fesse droite, position étrange pour le journal, comme si j’étais en attente d’autre chose, me lever, changer de lieu, exporter le journal depuis l’iBook vers internet, vers Pylône, vers Gilles. Le journal en attente d’une exportation, bon titre.
Jean-Pierre présente le journal de Hongrie aujourd’hui au Rectorat avec les enfants de l’an dernier, il les réunit, les arrache à leur nouvelle classe, les rembobine d’une année, il les regroupe, il part avec eux, une nouvelle fois, un nouveau bus, de Saint-Laurent à Nice, il les ramène avec lui, avec le livre, il participe avec eux à la Journée de l’Europe, mon nom va circuler, depuis la couverture de “Ça n’arrive pas souvent” à la bouche de Michèle Voisin, le journal de Hongrie renaît aujourd’hui pour quelques heures -au même moment, “Laura” termine sa vie quelque part dans Paris, Balland est mort, la destruction des exemplaires restants est peut-être imminente, si elle n’a pas déjà eu lieu.
Les livres, comme les enfants, loin. On enterre un neveu de Jean-Pierre aujourd’hui, qu’il ne connaissait pas, quinze ans.
copyright Laurent herrou
photo/copyright Jean Pierre Paringaux
lundi, mai 08, 2006
par LAURENT HERROU, le lundi 8 mai 2006

J’ai commencé à écrire la page du 8 le dimanche après-midi alors que le lundi n’avait encore rien eu à offrir. On sortait du cinéma, on avait vu “Transamerica”, il y avait des filles qu’on connaissait à la sortie, qui m’avaient demandé ce que j’en avais pensé puisqu’elles allaient voir la même chose à la séance suivante, j’avais refusé de leur répondre, elles avaient demandé : on ne va pas s’emmerder quand même? J’avais secoué la tête, expliqué que je n’aimais pas raconter un film comme je n’aimais pas qu’on me raconte, juste avant de rentrer dans la salle. Les filles avaient été d’accord, on était passé à autre chose, le boulot que l’une d'elles allait peut-être décrocher le lendemain dans une librairie de Nice, c’est à ce moment-là que ma tête s’est mise à cogner. Je suis sorti du cinéma, la lumière était encore très blanche. Le matin au café, j’avais été ébloui par le soleil, je ne parvenais pas à garder les yeux ouverts, j’avais demandé qu’on change de table, Jean-Pierre avait dit à Benoît que c’était tous les jours comme ça, à chaque fois une surprise, un mouvement de caractère, un inconfort. Il a demandé ce qui n’allait pas dans la rue devant le cinéma, j’ai répondu que j’avais un mal de tête soudain, il a trouvé ça bizarre, je savais que j’étais en train d’écrire, la machine s’emballait. On est remonté vers la maison, on est arrivé vers huit heures et quart, j’ai vérifié les mails, ajouté une photo à mon profile sur myspace.com -j’avais dû m’y inscrire pour pouvoir voir les vidéos de Kuta et de Sophie Moleta, qui au final, n’étaient pas encore en ligne. Jean-Pierre a noté que mon mal de tête n’allait pas s’arranger si je passais encore une heure devant l’écran de l’ordinateur, je lui ai répondu un peu sèchement qu’on n’avait le temps de rien, on sortait du ciné, il y avait la série “FBI portés disparus” à la télé à suivre dans quelques minutes, on n’avait pas eu le temps de manger, Jean-Pierre proposait de faire la cuisine tout en regardant le feuilleton, je me suis étendu dans l’obscurité de la chambre, les yeux injectés de sang, j’ai pris ma tête dans les mains en espérant que ça allait passer, Jean-Pierre a proposé une aspirine, j’avais avalé deux Dafalgan dans la salle de bains, j’ai été encore une fois un peu sec, il m’a demandé en riant de ne pas l’engueuler, je me suis mis à rire, désolé à mon tour, il a dit : si on ne voit pas “FBI”, ce n’est quand même pas la fin du monde. On a dîné devant la télé, je lui racontais ce qui se passait sur l’écran tandis qu’il réchauffait du lapin dans la cuisine. On est allé se coucher tout de suite après, il n’y avait pas de mails significatifs, je crois qu’on était crevé de la journée, sans raison, le temps avait pesé sur notre humeur, la menace de pluie qui ne se concrétisait pas et le plafond bas et lumineux des nuages, pour moi le dimanche n’avait existé que comme un prétexte à la page du lundi, cela faisait longtemps que je n’avais pas exercé sur moi-même une telle pression, j’ai eu un mal fou à m’endormir, je me suis réveillé dix fois dans la nuit, chaque réveil était l’occasion d’une première phrase brillante pour la page du lundi, quand le jour a enfin été là, je me suis levé le premier, ce qui n’arrive presque jamais, je suis passé sous la douche, j’ai préparé le petit-déjeuner, Jean-Pierre s’est levé à son tour, on a déjeuné, il a proposé un cinéma dans la matinée et devant ma mine un peu froissée, il a compris qu’il y avait une autre priorité.
J’ai rejoint le journal.copyright laurent herrou
photo/copyright jean pierre paringaux